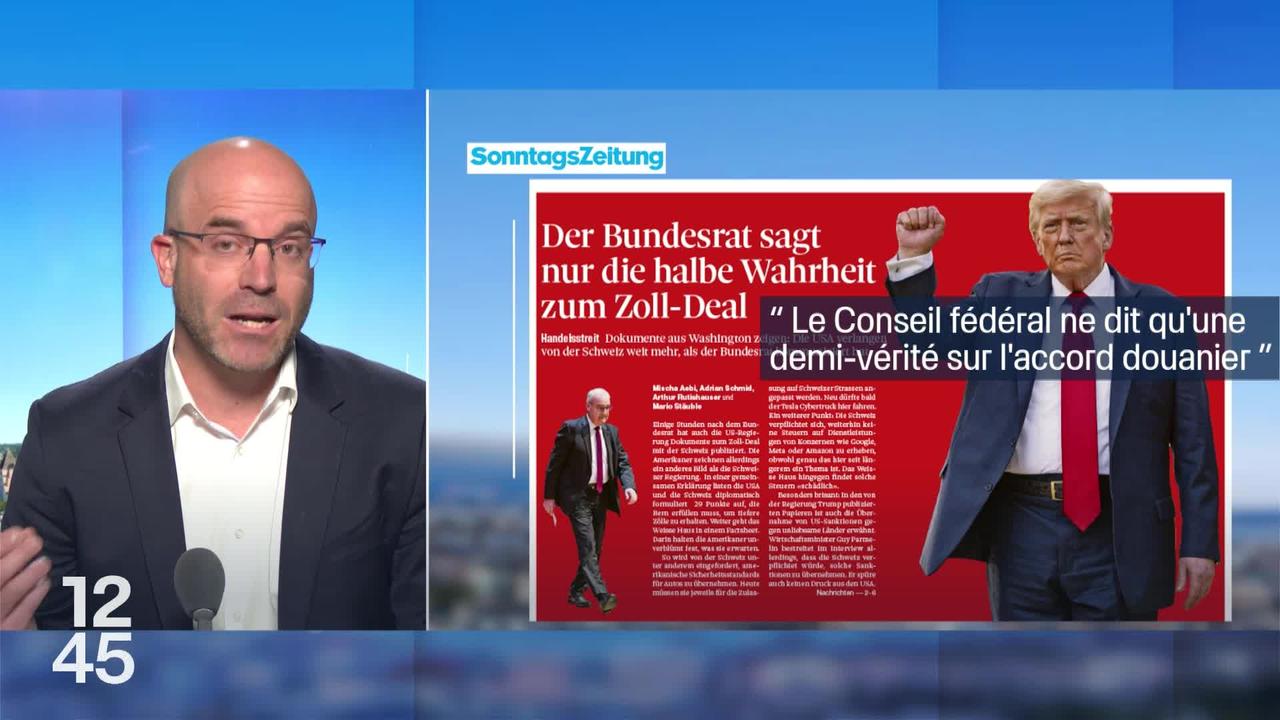Nouvelle étude suisse sur la fertilité masculine : des écarts régionaux
Une recherche menée en Suisse révèle pour la première fois des écarts entre milieu urbain et milieu rural en matière de fertilité masculine. L’analyse du sperme de milliers de recrues suisses montre qu’en raison d’un nombre de spermatozoïdes parfois faible, environ une personne sur six pourrait rencontrer des difficultés dans la conception naturelle d’un enfant.
Comprendre les critères de la qualité du sperme
La qualité du sperme repose sur trois critères : le nombre de spermatozoïdes, leur morphologie et leur mobilité. Lorsque l’un de ces éléments est limité, le risque d’infertilité peut augmenter.
Une étude régionale publiée et ses résultats
La recherche, dirigée par Rita Rahban, biologiste à l’Université de Genève, s’inscrit dans la continuité d’analyses menées avec des chercheurs de l’EPFL. Publiée fin septembre dans la revue Human Reproduction, elle met en évidence des groupes présentant des niveaux de qualité du sperme différents selon les régions.
Ainsi, dans un secteur situé au sud-est de Berne, la qualité du sperme est décrite comme relativement plus faible, tandis que dans une zone proche d’Aarau, des hommes présentent une qualité plus élevée que dans d’autres parties de la Suisse.
Les chercheurs observent une corrélation entre l’utilisation du sol et ces résultats : les zones entourées de cultures semblent s’associer à des valeurs plus faibles, tandis que les zones plus urbanisées affichent des valeurs plus élevées.
Facteurs qui influencent la qualité du sperme
Plusieurs éléments pourraient influencer la qualité du sperme. Certaines substances présentes dans les produits phytosanitaires pourraient impacter le développement des organes reproducteurs et la qualité du sperme. Selon les toxicologues, les métaux lourds contenus dans les engrais ou les hormones d’origine bovine utilisées dans l’élevage laitier pourraient également jouer un rôle.
Par ailleurs, des facteurs liés au mode de vie et à la santé générale influencent la spermatogenèse : chaleur, surcharge pondérale, alcool et tabac. « tout ce qui nuit à la santé en général affecte aussi les spermatozoïdes », rappelle la biologiste. En cas de changement de comportement, l’amélioration de la qualité du sperme pourrait apparaître après environ trois mois. Certaines influences, toutefois, échappent au contrôle individuel et pourraient être déterminées avant la naissance, par la génétique et l’environnement utérin.
Des observations indiquent notamment que les fils de paysannes, de coiffeuses et d’agentes de nettoyage, potentiellement exposés à des substances hormonalement actives pendant le travail, présentent une tendance à une qualité de sperme plus faible.
Liens possibles avec l’environnement et l’agriculture
Les polluants environnementaux et les pratiques agricoles pourraient influencer la fertilité masculine, mais les facteurs précis et leur ampleur restent à préciser. Comme le soulignent les chercheurs, les causes de l’infertilité masculine restent mal connues, et aucune mesure directe de polluants n’a été réalisée dans les groupes ou dans le sang des participants jusqu’à présent.
Selon Rita Rahban, le lien entre ces résultats et l’agriculture demeure une question ouverte. L’étude porte sur environ 3000 hommes, et son effectif invite à des recherches plus larges pour confirmer les groupes observés et leur lien possible avec les surfaces agricoles.
La toxicologue Ellen Fritsche, directrice du Centre suisse de toxicologie humaine appliquée (SCAHT) à Bâle, a cofinancé les recherches et souligne que l’étude est précieuse mais nécessite des examens plus étendus et plus précis. Une biosurveillance humaine permettrait notamment de mesurer l’exposition chimique, et une étude du désir d’enfant dans les groupes concernés aiderait à comprendre si les différences observées se traduisent par des écarts de fertilité.
Rédacteurs : Maj-Britt Horlacher et Kathrin Winzenried (SRF)